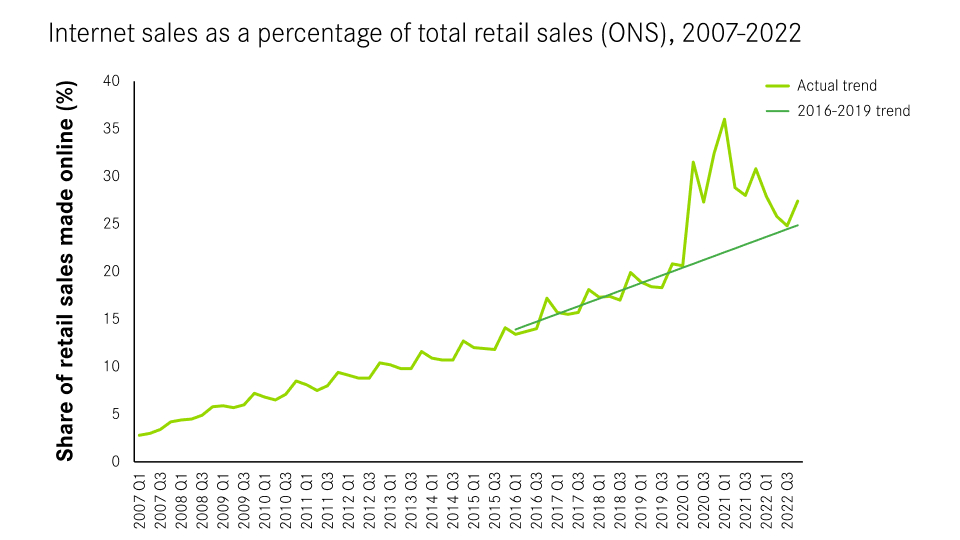Le 11 mars, cela fait cinq ans que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la pandémie de COVID-19. Il s'en est suivi une vague de chaos qui a mis la chaîne d'approvisionnement sens dessus dessous, l'obligeant à s'adapter, à se transformer et à apprendre à un rythme accéléré.
En plus de s'adapter à une pandémie mondiale, la chaîne d'approvisionnement a dû faire face à un barrage apparemment incessant de "périodes sans précédent" : Le blocage du canal de Suez, les incendies de forêt dévastateurs, la guerre en Ukraine, l'escalade des tensions en mer Rouge, les pénuries persistantes de copeaux, les pénuries de main-d'œuvre paralysantes et le spectre imminent de nouveaux droits de douane... La liste est longue.
À l'occasion de ce sombre anniversaire, nous revenons sur les trois impacts les plus importants et les plus durables qui ont fondamentalement remodelé les opérations de la chaîne d'approvisionnement et, ce qui est peut-être plus surprenant, sur les deux domaines qui sont revenus à un semblant de normalité.
3 changements à long terme de la chaîne d'approvisionnement
1. L'augmentation des délocalisations et l'abandon de ladépendance à l'égard d'une source unique
La pandémie a été un signal d'alarme qui a mis en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement interconnectées au niveau mondial et les risques d'une dépendance excessive à l'égard de fournisseurs éloignés et de stratégies à source unique. Bien que les chaînes d'approvisionnement mondialisées soient efficaces en période de stabilité, elles sont très vulnérables aux chocs soudains et généralisés, comme on l'a vu lors des premiers blocages et fermetures de frontières.
La pandémie a révélé des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement, qui ont été amplifiées par des événements ultérieurs, tels que les tensions en mer Rouge, qui ont fait chuter le trafic de marchandises d'environ 5 000 conteneurs par jour en novembre à 2 000 en décembre 2023. Ou encore la sécheresse du canal de Panama, qui a contraint les autorités à annuler les traversées de 36%, ce qui a coûté entre 500 et 700 millions de dollars.
Il en est résulté une évolution et une accélération vers le nearshoring, le reshoring et la diversification des sources. Près de 8 entreprises sur 10 (79% ) diversifient actuellement leur base de fournisseurs et 71% investissent activement dans la régionalisation et la localisation afin d'atténuer les perturbations futures.
L'étude de McKinsey montre que 73% des entreprises pratiquent désormais le double approvisionnement et que 60% régionalisent leurs chaînes d'approvisionnement. Cette évolution est une réponse directe à la perturbation causée par la pandémie, qui a mis en évidence les dangers d'une dépendance à l'égard d'un seul point de défaillance.
En outre, on assiste à une augmentation du "friend-shoring", avec 83% des organisations qui investissent dans ce domaine, ce qui démontre un désir de construire des réseaux d'approvisionnement plus stables et prévisibles. La pandémie a mis en évidence l'importance de la stabilité géopolitique et de la confiance, incitant les entreprises à privilégier les partenariats avec des alliés politiques et économiques.
La pandémie a agi comme un puissant catalyseur, accélérant l'adoption de stratégies de régionalisation, de diversification et de renforcement de la résilience. Elle a contraint les entreprises à réévaluer leurs modèles de chaîne d'approvisionnement, en s'éloignant des approches purement axées sur les coûts pour adopter un cadre plus robuste et plus adaptable.